Écrivain et universitaire, Gaëtan Brulotte a publié une quinzaine de livres, dont des recueils de nouvelles (Le surveillant, Ce qui nous tient, Épreuves, La vie de biais, La contagion du réel), un roman (L’emprise), une pièce de théâtre (Le client, créée au Festival d’Avignon, avec l’Aide à la Création dramatique du Ministère de la Culture (France), ainsi que des essais remarqués, notamment sur des genres littéraires injustement négligés et sous-estimés comme la nouvelle et sur des littératures jugées « mineures », comme dans son survol critique La nouvelle québécoise des origines à nos jours.
Il a sans cesse porté son attention sur des textes marginaux ou exclus de l’Histoire littéraire canonique et en particulier sur ceux qui explorent le désir, pour voir ce qu’ils nous apprennent sur la condition humaine, comme notamment dans Œuvres de chair. Figures du discours érotique et Encyclopedia of Erotic Literature en deux volumes chez Routledge à New York, le premier dictionnaire encyclopédique du genre, avec 200 collaborateurs de divers pays. Il a également publié sur la littérature française contemporaine (Les cahiers de Limentinus) et sur la création littéraire (La chambre des lucidités, Nulle part qu’en haut désir). à suivre
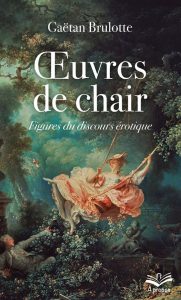
DÉPAYSEMENTS
ET
EXPATRIATION DU DÉSIR
C’est que le désir lui-même est voyage, dépaysement et arrachement à mon lieu.
Francis Affergan, Exotisme et altérité, 58.
Cet article examine rapidement les liens étroits qui s’établissent dans l’érographie [1] entre le plaisir et ce qu’on appelle, en gros, le dépaysement. Autour de la sexualité se déploie, en effet, tout un code de l’extranéité dont on peut considérer quelques modalités majeures d’inscription.
LES FORMES
On distinguera quatre formes de dépaysement géographique. D’abord, l’expatriation de l’amour. L’action luxurieuse se situe très souvent dans une contrée étrangère ou dans un ailleurs lointain et flou. Ainsi, dans Les Cent Vingt Journées de Sodome de Sade, les libertins se sont retirés à Silling, « hors de France », dans la Forêt-Noire. Dans cette veine, la fin du XIXe siècle voit apparaître le roman érotico-exotique dont l’intrigue se déroule loin de l’Occident avec des scènes pleines de couleur locale, comme dans Une nuit d’orgies à Saint- Pierre-Martinique de F.G.H. où le créole se mêle au dépaysement du cadre. Expatriation analogue des écarts de Wanda et Séverin dans La Vénus à la fourrure de Sacher-Masoch, lesquels ne sont possibles qu’à l’extérieur de leur pays, à Florence. Les nouvelles érotiques d’Anaïs Nin ont lieu au Brésil (« L’Internat»), au Pérou (« L’Anneau», « Mathilde »), à Majorque et en Suisse (« Élena »), dans une fumerie d’opium orientale (188). Dans d’autres récits, les personnages français évoluent plus ou moins à distance de l’Hexagone : l’Histoire de l’œil de Bataille se passe en majeure partie en Espagne; un épisode de La Révocation de l’édit de Nantes de Klossowski à Rome ; ou, encore, le Château de Cène de Bernard Noël dans une île fortunée de l’Atlantique Sud, miraculeusement préservée des atteintes de la civilisation restrictive. Emmanuelle déménage à Bangkok. L’Éden de Guyotat élit domicile dans les régions désertiques d’Afrique du Nord, etc. L’amour franchit aisément les frontières et va s’épanouir là où le climat exubérant, la nature excessive, la vie féconde en plaisirs fournissent un cadre propice à son développement À d’autres moments, le nomadisme donnera à la matière romanesque un point de sortie et de renouvellement: les personnages ne sont pas alors installés à l’étranger, mais ils sont en transit. Ils voyagent d’un endroit à un autre, ce qui brise l’unité de lieu. Dans ce cas, la pérégrination sert moins pour ses vertus de pittoresque que comme opératrice de rencontres et pourvoyeuse d’expériences inédites. Le Bleu du ciel de Bataille se déplace ainsi à Londres, en Allemagne et à Barcelone. Une bonne partie de Juliette de Sade se déroule au cours d’un déplacement des personnages vers l’Italie, « la patrie des Nérons et des Messalines » (VIII, 541), et vers la Sibérie : les visiteurs y découvrent moins des paysages typiques que de nouvelles possibilités transgressives en même temps qu’ils apportent avec eux leurs savoir-faire personnels et leurs spécialités nationales.
On peut, par contre, restreindre le terme d’exotisme proprement dit à ce type de dépaysement sédentaire, passif et importateur qui est provoqué par des objets. Soit par le vêtement : ainsi, à Silling, dans Les Cent Vingt Journées, costume-t-on, au départ, les corps désirés à l’asiatique, à l’espagnole, à la turque, à la grecque (« et le lendemain autre chose », précise-t-on). Soit à travers le mobilier: comme celui, par exemple, très hétérogène et rassemblé dans un même espace érotique d’Histoire d’O : une table chinoise, un divan français (où l’on boit du whisky écossais), une table paysanne, une commode d’époque Régence, des matelas cambodgiens, un lit à l’italienne à quoi s’ajoute « l’air chinois » d’un personnage. Cet hétérogène est trop excessif pour ne pas être cultivé : on y sent un travail conscient sur le code de l’extranéité qui cherche à dissiper les racines jusque dans le plus modeste espace domestique.
L’érographie exploite aussi systématiquement l’importation de partenaires sexuels : soit allochtones (simples immigrants), soit allogènes (de race différente). Félicité de Choiseul-Meuse fait naître la narratrice de Julie à Naples. Dans Histoire d’O participent aux ébats ou évoluent dans les lieux de plaisir tel sujet anglais, tel Américain, une Russe, une mulâtresse (la servante Norah) et même le chien d’Anne-Marie au nom suggestif (Turc). Dans La Correspondance d’Eulalie, Paris fourmille d’étrangers, puisque la France est envahie par l’ennemi anglais en cette période de guerre autour de 1785 ; indifférentes aux vicissitudes politiques, les demoiselles accueillent chez elles Anglais, Espagnols, Italiens, Russes, de sorte qu’«avec le temps, dit l’une d’elles, j’espère que j’aurai eu des entreteneurs de toutes les nations de l’Europe» (An. IV, 254). Dans Le Diable au corps de Nerciat, le petit sérail parisien du Tréfoncier (lui-même Allemand) se compose d’une Languedocienne, d’une Flamande, d’une sauteuse espagnole, d’une Érigone anglaise, d’un soprano florentin et d’une Africaine. Les Onze Mille Verges d’Apollinaire se déroulent dans une Bucarest où se mêlent l’Orient et l’Occident : aux prouesses sexuelles d’un personnage président Albanais, Allemands, Japonais, Monténégrins, Roumains, Serbes, Turcs… Chez Anaïs Nin (43), on aperçoit des bordels avec des Syriennes, des Arabes, des Japonaises, des Chinoises, des Africaines, des Françaises. Dans La Femme de papier de Françoise Rey, incarnent la nouveauté exotique, pour la narratrice blanche et française, un jeune amant Beur, des homosexuels noirs africains, un travesti noir aux pommettes kalmouks. À un niveau plus modeste, l’amant de Duras et celui d’Ernaux sont chinois et russe : dans Passion simple, il ne parle même pas français. Bref, bien avant le développement du multiculturalisme au sein de la mondialisation de la planète, le lit d’amour était déjà cosmopolite, la chambre de plaisir, un carrefour international.
Expatriation, nomadisme, exotisme, importation et ce n’est pas tout, car il y a un autre aspect à considérer, et un Théophile Gautier vient ici nous aider à compléter ces données : Il y a, déclare-t-il aux Goncourt le 23 novembre 1863, deux sens de l’exotique :
le premier vous donne le goût de l’exotique dans l’espace, le goût de l’Amérique, le goût des femmes jaunes, vertes, etc. Le goût plus raffiné, une corruption plus suprême, c’est ce goût de l’exotisme à travers le temps : par exemple, Flaubert serait heureux de forniquer à Carthage; vous voudriez la Parabère (maîtresse du Régent – 1693-1750) ; moi, rien ne m’exciterait comme une momie.
Le dépaysement historique est peut-être plus insolite encore que le géographique : voilà bien ce que sentent les libertins sadiens, par exemple, qui ne cessent d’invoquer les mœurs des Anciens (Romains) pour étayer leurs thèses et justifier leurs passions ; ou ce qu’évoquent les œuvres de Pierre Louÿs consacrées aux voluptés d’une autre ère, dans son roman de mœurs antiques, Aphrodite ; ou ce que montre aussi l’atmosphère médiévale du récit de Muntaner, Anne et les miroirs. On vit le dépaysement temporel sous le mode de la nostalgie (Louÿs) ou sous celui du fantasme (Muntaner) ou sous celui de l’achronie (Sade). Ainsi que l’écrit Affergan (172): « L’altérité se mesure plus […] au niveau de l’appréhension d’une nouvelle temporalité qu’à celui d’un nouvel espace nécessairement plus circonscrit. »
LES BUTS
Si l’on considère un moment ces premiers éléments descriptifs du dépaysement, on constate qu’il ne s’agit pas vraiment d’un exotisme érudit. Le but du voyage n’est pas de révéler un pays étranger, de collectionner des paysages, de peindre des lieux insolites, d’offrir une enquête ethnologique ou quelque document géographique ou historique. Les personnages ne voyagent pas en touristes, en explorateurs ou en anthropologues, encore moins en pèlerins, en soldats ou en marchands. Ne les animent aucune curiosité intellectuelle, aucun souci d’évangéliser, de conquérir ou de trafiquer. Plus que par simple désir de voir et de savoir, ils se déplacent pour jouir davantage, pour s’arracher à eux-mêmes, pour atteindre l’extase la plus inédite et la plus totale, pour se repaître de l’altérité la plus grande, pour se perdre à son contact, pour bouleverser leurs repères identitaires et rompre avec toute réalité spatiotemporelle. On va au loin, certes, pour éprouver la coupure radicale et le transport absolu, mais aussi pour le renouvellement de soi. Le voyage est un support initiatique, dit Éliade dans Initiations, rites, sociétés secrètes, puisqu’il permet de renaître autre et ailleurs. C’est bien ce qui arrive souvent aux personnages de l’érographie : le voyage leur fait connaître une renaissance.
Cette constante du dépaysement par le voyage nous indique au moins qu’on ne peut vivre pleinement sa sexualité qu’en échappant au poids des us. Sur un plan plus familier, la coutume du voyage de noces semble participer de cette même exigence : on ne possède vraiment l’autre qu’en dehors du territoire. Il semble que le désir ne puisse explorer l’altérité qu’en vivant une autre altérité, celle du lieu. Ce faisant, on découvre l’autre moi qui se cache au fond de soi-même, puisque l’inconscient ne s’épanche librement qu’au loin.
Les voyages érographiques rappellent la dimension, si importante dans cette littérature, de l’aisance et de l’oisiveté, car ils supposent une relative disponibilité des personnages (ils n’ont apparemment aucune obligation qui les lie à leur territoire d’origine) et ils supposent une certaine richesse, l’argent étant un facteur réaliste qui compte dans l’instauration du dépaysement, même si on n’en fait que rarement mention.
Si on recherche le dépaysement, c’est encore par goût du paradoxe (prenons, bien sûr, ce mot au sens étymologique : contre la doxa, contre le sens commun). C’est ce rôle subversif que jouent, chez Sade, les fameux catalogues de curiosités dans lesquels, pour un écart donné, on en recense, à travers le temps et l’espace, les diverses manifestations exotiques : on produit ces compilations encyclopédiques certes pour parodier le savoir, mais aussi pour relativiser l’idée de Loi et dissoudre toute norme morale. « Les écarts de mes personnages, semble dire l’érographe, peuvent vous scandaliser, mais à telle époque ou dans tel pays, c’était ou c’est encore pratique courante. » Comme le dit le fameux adage : Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà…
En multipliant les points de références, le discours exotique ruine l’ordre d’un système de valeurs et fait éclater son organisation concentrique. C’est bien là une démarche paradoxale qui, en prenant en considération une altérité et en reconnaissant des différences, en arrive à récuser le monde tel qu’il est.
À suivre…..
liens : site de Gaëtan Brulotte