Entretien mené par Claire Tencin avec Florence Dosse sur le traumatisme de la postguerre d’Algérie dans les familles françaises.
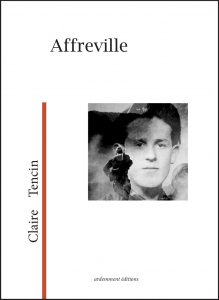
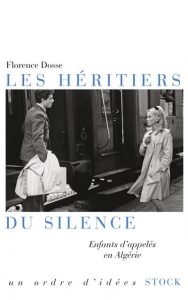
CT : Comment est né votre livre Les héritiers du silence ? Quel en est l’élément déclencheur ?
FD : Les déclencheurs sont multiples. L’élément majeur, que je cite dans mon livre, vient d’une histoire que mon fils m’a rapportée autour de 2001. Des années auparavant, mon père lui avait raconté qu’il avait fait boire des Algériens pour obtenir des renseignements, et qu’ensuite ces Algériens étaient morts, je ne sais pas de quelle manière ni qui les a tué. Pour moi cette histoire a été extrêmement violente car je n’avais pas réalisé jusque là que mon père avait pu être impliqué dans la mort d’autres hommes. Entendre cela a été un véritable choc, mais j’ai eu aussitôt le réflexe de remercier mon fils : par cette révélation, il m’ouvrait les yeux sur tout un pan d’histoire que je n’avais jamais saisi jusque là.
Je pense que je commençais depuis quelque temps à être travaillée de l’intérieur par la guerre d’Algérie. J’avais lu à sa sortie en 1999, le beau livre de Claire Mauss-Copeaux Appelés en Algérie, la parole confisquée, publié chez Hachette. Elle a été pionnière dans le travail d’enquête sur la mémoire des appelés. A titre personnel, il a quand même fallu que j’attende d’avoir 36 ans pour pressentir que j’étais reliée à une histoire commune, sans vraiment encore en avoir une claire conscience.
Après le récit de mon fils, j’ai appris un peu plus tard que mon père était sur la ligne Morice et j’ai réalisé qu’il avait sans doute vécu des moments très durs. Ensuite, pendant deux ans, j’ai été tourmentée par la honte. Je redoutais que la guerre d’Algérie ne soit évoquée dans les conversations, j’aurai voulu disparaître quand c’était le cas, tant cette honte était puissante. Puis peu à peu, j’ai dépassé cela en reliant mon histoire personnelle à l’histoire collective. Et plutôt que de chercher à savoir ce qui s’était passé pour mon père, qui n’avait pas envie d’en parler, j’ai entrepris de me tourner vers d’autres familles d’appelés disposées à témoigner, pour tenter de comprendre comment les mémoires intimes et la mémoire collective avaient pu alimenter mutuellement le silence sur cette page si sombre de notre histoire, à la lumière de ce que qui s’était dit ou tu dans la société française pendant et après la guerre. Un million d’appelés, cela fait beaucoup d’enfants : nous sommes nombreux et nous en parlons peu, ce n’est pas un sujet de conversation que j’ai eu avec ceux de ma génération. Mais à un moment donné, je me suis sentie reliée à cette histoire collective, bien qu’elle ne soit pas partagée. Et cela a été fondamental, car c’est un lien social qui émergeait ainsi. Depuis que je travaille sur ce sujet, je constate que beaucoup de gens ont une histoire en lien avec cette guerre, même si le récit personnel commence invariablement sur le mode : ” Il n’a jamais rien raconté… “
Quelle méthode avez-vous mise en place pour faire votre recherche ?
Je suis entrée en contact avec des appelés en m’adressant aux associations d’anciens combattants. J’ai rencontré des responsables nationaux et locaux de la FNACA, de la FNCPG-CATM, de l’ARAC et de l’UNC dont les différences de sensibilité politique sont bien marquées, ce qui m’a permis d’approcher des témoins aux opinions variées. Ceux-ci ont été très faciles à trouver, et à partir du moment où ils étaient partants pour me rencontrer, ils ne demandaient qu’à se raconter ” leur guerre d’Algérie ” à quelqu’un qui s’intéressait enfin à ce vécu après des décennies de silence.
Pour ma part cela dit, ce n’était pas en soi leurs souvenirs de la guerre d’Algérie que je cherchais à entendre. L’orientation de mes questions était néanmoins dirigée sur la mémoire et sur le partage de cette mémoire : comment ce vécu avait depuis continué à vivre en eux, et comment la transmission – ou la non transmission – avait-elle pu se faire, quelle communication y avait-il eu avec leur entourage depuis leur retour ?
Combien d’appelés avez-vous rencontré ?
En tout, j’ai vu une cinquantaine de personnes, avec une proportion égale d’appelés, de femmes, et ” d’enfants ” quarantenaires au moment de nos rencontres. Avant de voir les femmes, j’ai d’abord entendu des enfants, qui n’étaient toujours ceux des parents que j’ai interrogés. J‘ai vraiment donné la parole à qui avait envie de parler. Je n’ai pas cherché à arracher des histoires extraordinaires.
J’ai mené mon enquête pour partie à Paris, et dans le Limousin. C’est à Paris que j’ai vu le plus grand nombre d’appelés officiers en Algérie, ceux qui venaient du Limousin étaient tous de simples soldats, ce qui donne là aussi des regards différents ; les uns avaient la responsabilité des hommes qu’ils encadraient, les autres recevaient et appliquaient les ordres.
Oui, on sent dans votre ouvrage que les témoignages sont ” propres “, les propos assez contenus alors que l’on pourrait s’attendre à des confessions plutôt choquantes au regard ce qu’ils ont dû vivre sur le terrain.
La méthodologie et l’objectif de l’enquête n’étaient pas destinés à obtenir ce genre de récits : je les voyais pour un entretien unique. Si j’avais entretenu avec eux une relation dans la durée, d’autres lièvres auraient peut-être été soulevés en effet. Mais mon but, encore une fois, n’était pas de faire émerger des souvenirs de guerre en tant que tels, ce que je voulais c’était les entendre sur la façon dont ils vivaient depuis lors avec leur mémoire, et sur ce qu’ils avaient pu partager avec leur entourage proche. Il y a tout de même le témoignage fort et douloureux d’un appelé expliquant qu’il lui a fallu plus de quarante ans avant de pouvoir dire aux siens qu’il avait été contraint de tourner la manivelle de la gégène : il ne s’en est jamais remis. Et si la majeure partie des souvenirs personnels livrés en entretien restent en partie couverts, beaucoup de récits de seconde main, rapportés soit par les appelés, soit par leurs enfants, sont loin d’être ” propres “.
J’ai le sentiment que dans ce silence des générations dont vous parlez, il y a encore un tabou fort, celui du père tout puissant. Est-ce que les enfants ont des scrupules à toucher à l’image paternelle ?
Je ne sais pas si c’est un tabou à proprement parler, je crois qu’il n’y a jamais eu de tabou dans les familles en ce qui concerne le service algérien du père, mais cette page de guerre était en quelque sorte lettre morte. Ce passé était perçu de façon assez abstraite, et semble avoir été longtemps sans consistance, sans résonance pour les enfants. Quant à l’image du père, la représentation d’un homme tendu, taciturne et autoritaire, avec ” un cœur de pierre ” ressort assez souvent. Certains enfants vivent avec ce sentiment étrange que quelque chose a pesé sur la famille pendant leur enfance, comme une chape de plomb dont ils ne connaissent pas l’origine. Ceux qui sont nés dans les premières années de l’après guerre, au tout début des années 1960, ce qui est le cas de la majorité de ceux que j’ai entendus, ont été éduqués de manière très traditionnelle. Mai 68 n’avait pas encore ébranlé l’autorité paternelle et la distribution des rôles familiaux. Dans le Limousin plus encore qu’à Paris, on me racontait qu’on ne parlait pas à table, que la mère tenait la maison et que tout devait être prêt quand le père arrivait, les repas se déroulant ensuite en silence. Je ne sais pas si c’est le souci de ne pas porter atteinte à l’image du père qui entretient le silence chez les enfants, il peut par contre y avoir en effet une sorte de peur persistante qui habite les enfants d’appelés, aujourd’hui encore. Comme s’il leur restait difficile de mettre en doute et d’affronter la force paternelle affichée dans leur enfance par un père qui se voulait inébranlable, derrière sa carapace ou son armure protectrice.
Pour les appelés, partis pour de longs mois en Algérie, ce vécu transitoire, cette page de guerre est venue faire effraction et conserve tout son poids par-delà les années : l’effacement des souvenirs et l’oubli leur a été impossible. Leurs enfants ont pressenti ce poids, au travers des bribes de récit qu’ils ont entendu de loin en loin, mais aussi dans tout ce qui pouvait circuler hors les mots, par des crispations, des moments de fermeture totale, des réactions soudaines de leurs pères. C’est de cela qu’ils sont héritiers, et il leur en reste comme un corps étranger, inassimilable, à la fois très présent et non métabolisé. C’est ce que démontrent les travaux sur le transgénérationnel : les traumatismes parentaux glissent vers les générations suivantes, qui sont habitées par ces non-dits qui se transforment pour eux en impensé. Et ces non-dits qui travaillent leur psyché de l’intérieur, sans qu’il leur soit possible d’en cerner la matière et la provenance, sont souvent imprégnés d’une honte, venue d’on ne sait où.
Comme vous l’expliquez dans votre ouvrage, le silence sur la guerre d’Algérie a été maintenu jusqu’à aujourd’hui malgré les publications, les films, et les programmes scolaires. Pensez-vous que les enfants d’appelés puissent reproduire une forme de déni ?
Ils continuent d’être vecteurs du silence d’une certaine manière. Quand ils évoquent l’idée d’en parler avec leur père, la majorité d’entre eux sont prudents, n’osent pas le questionner ou ne veulent pas forcer des aveux. Après tout ce temps, ça vient ou ça ne vient pas, disent-ils. Déni, je ne sais pas mais surdité et aveuglement, certainement. Pour ma part, tout au début de ma recherche, j’ai soudain pris conscience que ces soldats avaient vingt ans quand ils se sont retrouvés en Algérie : mes propres enfants atteignaient cet âge là à ce moment là. C’était stupéfiant de réaliser qu’en d’autres temps, ils auraient pu être appelés, contraints par la hiérarchie militaire à se battre, voire à tuer. Et jusque là je n’avais jamais vraiment imaginé mon père enfant, j’avais de lui une image unique : celle de l’homme fort qu’il avait toujours voulu incarner aux yeux des autres me semblait-il. Je crois que le silence contribue à l’incapacité de se représenter son père de façon souple, naturelle, et contribue à renforcer une image assez monolithique.
Pour sortir du silence à la génération suivante, pour ouvrir les yeux et les oreilles sur ce passé enfoui, il faut qu’il y ait un moment de choc. Dans l’enquête, on le voit bien, pour les rares enfants qui menaient des recherches individuelles sur le passé de leur père, leurs questionnements sont généralement activés par un faisceau de signes. Des signes dans la société et des signes dans l’entourage personnel. Depuis les années 2000, la guerre d’Algérie est de plus en plus ” sous les feux de la rampe “. Les dossiers qui paraissent dans la presse, les documentaires diffusés à la télévision sont à portée de tous et peuvent à tout moment percuter la conscience d’un enfant d’appelé qui soudain s’attarde sur les exactions commises en Algérie. La mort du père peut aussi être un facteur déclencheur d’interrogations nouvelles. Dans ce cas, les appels venus de la société et le décès du père se conjuguent pour faire éclore ce passé longtemps enfoui sous le silence. Aujourd’hui on est nettement dans une phase d’hypermnésie : 115 livres vont être publiés en 2012 sur la guerre d’Algérie, c’est énorme.
Avez-vous senti des différences entre les garçons et les filles d’appelés ? J’ai l’impression que les filles sont plus courageuses dans leur quête.
Je ne sais pas si je dirais ” courage “. Il y a peut-être une approche et une sensibilité différentes. Je pense en effet à plusieurs filles d’appelés qui ont voulu savoir, comprendre, et qui se sont confrontées à la fois à un passé douloureux et aux résistances de leur père pour aller plus loin dans la connaissance de cet héritage. A leurs côtés, je pense aussi à Cyril qui est selon moi un héritier traumatisé par le traumatisme de son père, qui lui a déversé des horreurs dans les oreilles. Sa mère ne voulait pas que son père parle et réagissait avec virulence quand elle voyait qu’il allait se mettre à pleurer. Les épouses ont été le plus souvent des gardiennes assez passives du silence, et celles, moins nombreuses, qui sont intervenues ont été plutôt coercitives : elles les ont empêché de parler. C’est ce que disent les enfants. En réponse à la question que vous posiez tout à l’heure, ce sont peut-être plutôt parmi la génération des femmes qu’on peut en trouver certaines qui ne supportaient pas que l’image du père s’effondre, que l’homme pleure, alors que les guerres précédentes avaient fabriqué des héros dans les souvenirs familiaux, c’est possible…
De quoi parlent les anciens soldats quand ils parlent de leurs cauchemars, qui subsistent aujourd’hui encore ?
Quand ils évoquent leurs cauchemars, ils semblent surtout faire ressurgir la peur liée au danger qu’ils ont connu pour eux-mêmes. Ce sont des images de voitures qui tombent dans les ravins, de peur panique à l’idée de se faire tirer comme des lapins, de violents corps à corps que certains ont connu. Dans leur vie quotidienne, quelques-uns gardent encore des réflexes de défense, en se protégeant dos au mur au restaurant ou dans un lieu public… les peurs sont toujours actives. C’était une guerre sans front, une guerre aveugle, l’autre n’était pas au bout du fusil, la plupart du temps les soldats étaient emmenés en opération sans voir leur ennemi, ce qui a entretenu chez eux un qui-vive durable.
Avez-vous entendu de la haine ou du racisme ?
Certains conservent un vocabulaire qui leur vient tout droit de leurs années algériennes, pétri à la fois de mots de ” là-bas “, mots d’arabe, et de termes racistes dont ils usaient alors quotidiennement. Les hommes se surveillaient quand je les ai interrogés. Quelques femmes m’ont dit que leur mari avait continué à utiliser des dénominations péjoratives comme ” bougnoules, bicots, fells ” bien après leur retour : ” Ah, il a toujours parlé comme ça ! ” Lors des entretiens, ils parlent de la découverte d’un autre peuple, pour beaucoup d’entre eux, c’était la première fois qu’ils s’en allaient à plus de 200 km de chez eux. On leur avait dit que l’Algérie, c’était la France : quand ils sont arrivés, ils ont découvert l’inconnu, un pays totalement exotique, une terre de soleil, avec des paysages magnifiques qui les ont marqués. Ils ont été surpris par les comportements de certains français d’Algérie, par le décalage entre la richesse de certains et la pauvreté des villageois dans les campagnes, ils ont été frappés par la manière dont les Algériens traitaient leurs femmes. Ils ont été surpris et un peu effarés de voir comment s’exerçait la domination masculine d’une part, et la domination des ” colons ” sur les Algériens d’autre part, même si des relations interpersonnelles fortes pouvaient exister. Ils sont partis sans conscience claire de ce qui les attendait de l’autre côté de la Méditerranée, et à une fois là-bas, n’ont jamais réussi à vraiment comprendre ce qu’ils faisaient sur ce sol algérien. On leur avait dit qu’ils allaient faire leur service militaire dans trois départements français et ils débarquaient dans un pays qu’ils ont immédiatement vu comme étranger. Ce service a été vécu dans un sentiment de non sens par la plupart. Ils se sont trouvés embarqués dans la violence alors qu’on leur répétait sans cesse que ce n’était pas une guerre, mais du maintien de l’ordre. Alors, le racisme, impossible de faire de généralité sur la question : je ne pense pas que les appelés soient statistiquement plus ou moins racistes que les autres, leur expérience a nourri leur vision du monde de façon différente selon la sensibilité politique qu’ils ont développée depuis.
Les hommes ont-ils ressenti un sentiment d’abandon en Algérie et ensuite à leur retour en métropole ?
Les femmes sur le continent vivaient elles aussi dans l’ignorance. Elles ne savaient pas ce que vivaient les hommes là-bas, n’avaient pas connaissance de la dureté des combats, des exactions dont ils pouvaient être témoins ou davantage. Les femmes que j’ai interrogées m’ont dit qu’elles ne s’étaient pas inquiétées. En effet, il y avait de la frustration, du manque, de l’absence, mais pas tellement l’angoisse de ne pas les revoir. Cela été pour moi l’une des plus grandes surprises de mon enquête, qui s’explique par la relative indifférence de la société française de l’époque, bien plus occupée à son développement et à la découverte des joies de la consommation que disposée à s’attarder sur ce qui se passait outre-Méditerranée. Dans les familles, ces jeunes fiancées étaient gentiment rabrouées, leurs craintes ont été anesthésiées. Et le courrier qu’elles recevaient y participait aussi : les hommes se voulaient rassurants et ne s’autorisaient pas à raconter grand-chose, du fait aussi de leur crainte de la censure et des réprimandes dont ils risquaient d’être l’objet au sein de l’armée.
La transmission aujourd’hui où en est-elle ? Est-ce que les livres sont suffisants ? A-t-on un relais médiatique suffisant ?
Toute action qui tend à dégorger les mémoires y contribue. Le travail de mémoire est très complexe. Les amnisties qui ont eu lieu de 1962 à 1982 n’ont pas favorisé le travail de mémoire au plan national. Blanchir tout le monde est une façon d’orchestrer l’oubli et de construire de l’amnésie collective. Ce qu’on constate, au plan mémoriel, c’est qu’il n’existe pas de récit national, seulement des tentatives partielles, morcelées. Depuis 2001, des dates commémoratives ont été instituées, donnant ainsi une ” part de gâteau ” à chaque communauté, ce qui au final, risque de les isoler les unes des autres. La journée nationale d’hommages aux harkis le 25 septembre, la plaque apposée en mémoire du 17 octobre 61 sur le pont Saint-Michel, le 5 décembre, journée nationale d’hommage aux morts pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, date qui n’est que celle de l’inauguration du Mémorial du quai Branly en 2002, alors que la FNACA et l’ARAC continuent de revendiquer la date du 19 mars, jour du cessez-le-feu… Construire une mémoire collective apaisée reste encore très difficile. Beaucoup de porteurs de mémoire continuent d’être dans une posture revendicative, dans une demande de reconnaissance qui communautarise les mémoires. En témoignent aussi les stèles et les musées du Sud de la France, où vivent de nombreux Pieds-noirs, qui visent surtout à rappeler les oeuvres de la France en Algérie.
Au niveau national, la mémoire n’est pas véhiculée de manière transparente et assumée. On se souvient notamment du projet de loi du 23 février 2005 qui voulait entériner l’action positive de la colonisation. Autre exemple, le Ministère de la Culture et de la Communication publie tous les ans un annuaire des commémorations, textes d’historiens à l’appui. L’historien qui s’est vu confier la présentation de la guerre d’Algérie a été censuré : OAS, Harkis, de Gaulle tous ces termes ont été retirés… et ça se produit en 2012. On assiste d’autre part à une judiciarisation de l’histoire, bien au-delà du seul contexte de la guerre d’Algérie, avec les tentatives de chaque communauté réclamant que l’État émette des lois commémoratives et que les préjudices portés à la mémoire de tel ou tel groupe soient punis. L’historien Pierre Nora, entre autres, s’est opposé au travers de l’association ” Liberté pour l’histoire “, à ces lois mémorielles contreproductives qui alimentent les communautarismes et les revendications victimaires. Pendant ce temps, le gouvernement continue à produire ces lois mémorielles, moyen de flatter les corps électoraux. Concernant la guerre d’Algérie, si date il devait y avoir, une solution serait peut-être d’instaurer une date unifiée qui permette de transmettre cette mémoire plurielle en regardant le passé en face. Pour enfin dépasser cinquante ans après, les antagonismes qui continuent d’alimenter les tensions non seulement entre les acteurs d’alors, mais aussi entre leurs descendants. Une chose est sûre, si nous avons à commémorer la guerre, il faudrait que ce soit pour réunir les mémoires, non pour les opposer, en revenant à la simple étymologie du mot commémorer : se remémorer ensemble